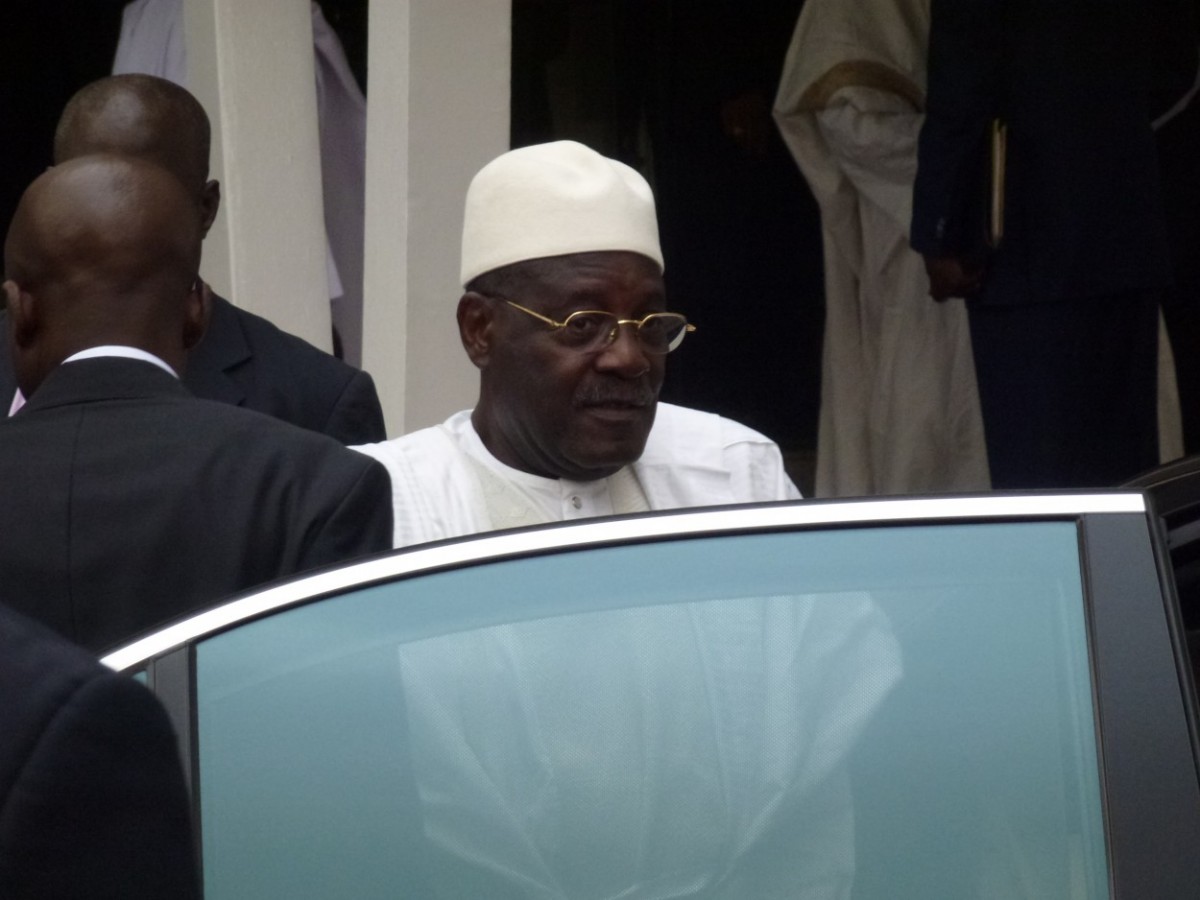Je n’aime pas la comptabilité
 Je n’aime pas les jeudis. Le jeudi est une journée morose, coincée dans le coeur de la semaine.
Je n’aime pas les jeudis. Le jeudi est une journée morose, coincée dans le coeur de la semaine.
Aujourd’hui c’est jeudi et j’ai envie de me sauver par la fenêtre, d’escalader cette pile de papiers qui me fait face avec acharnement et de me retrouver à gambader dans les champs là-bas dans mon village. C’est souvent les jeudis que l’envie me prend de tout plaquer et de partir loin, de rentrer chez moi. Les jeudis, je rêve d’herbe coupée et du clapotis que font ces petites carpes dans les eaux claires de Hina, la petite rivière qui irrigue la patrie de mes grands-parents dans la Sanaga Maritime.
Seigneur ! J’aimerais tant être hors de ce bureau. Je n’arrive même plus à distinguer la couleur de la peinture sur les murs. Impossible de trouver une nature plus morte…
Je dessine des bonshommes sur le calendrier qui me sert de sous-main. Un calendrier de 2008 maltraité par les ratures de stylos récalcitrants. De toute façon, ce calendrier était déjà vieux d’un an quand je l’ai placé là. Ce jeudi, je suis sidéré que le temps passe si vite. J’ai l’impression de ne pas être à ma place, de participer à un opéra lyrique effrayant joué en gaulois, si tant il est vrai que le gaulois est la langue morte la plus inerte du monde.
Les jeudis, je n’arrive pas toujours à donner un sens à mon existence. Et parfois, je suis si triste ! Je repense souvent à mes années d’école, de collège. Je voulais devenir quelque chose d’autre qu’un clerc derrière une pile de papier et de chiffres. C’est vrai que je ne peux pas dire de manière autoritaire ce que j’aurai voulu être d’autre. Écrivain, journaliste, professeur, pilote ? Je ne sais toujours pas ce qui me passionnait le plus.
Mais autant que je m’en souvienne, j’ai toujours voulu échapper à mon destin. Je m’appelle Jean-Paul et je suis devenu ce que je n’aurai jamais dû être : comptable.