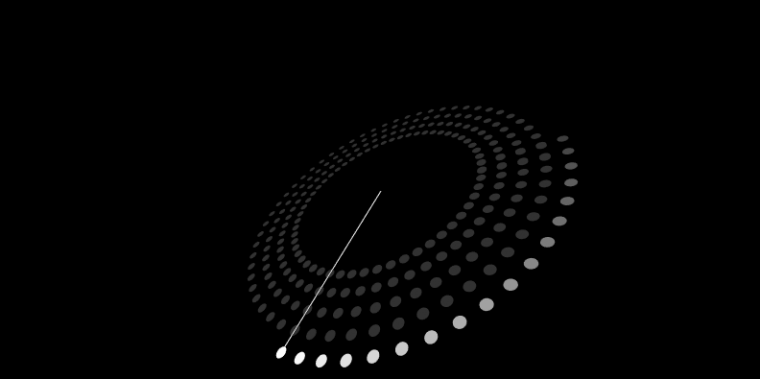Ancien détenu de la prison Tcholliré au Cameroun, il raconte son calvaire
Ce matin-là, j’étais à la rédaction de La Nouvelle Expression à Yaoundé. Il n’y avait pas grand-monde. Un homme est entré. Grand, une barbe de plusieurs jours, la cinquantaine et vêtu d’un survêtement de sportif. Il voulait rencontrer un journaliste. C’était un jour de novembre 2013. Il y avait une tristesse indicible dans ses yeux et une voix pâteuse. Presque déséquilibré… Je ne voulais pas lui parler, mais j’étais le seul journaliste présent. Je lui donné une chaise et il a commencé à parler. Très vite, je compris qu’il était un ancien prisonnier, condamné à mort et qu’il s’appelait Germain Belibi. Je l’ai écouté avec plus d’attention lorsqu’il m’a dit qu’il a été élargi à la suite d’une grâce présidentielle en 2003. Dix ans plus tard, l’homme émacié qu’il était devenu a décidé de briser le silence sur ses conditions de détention et sur l’ »arbitraire » qui lui a enlevé 20 ans de sa vie. Voici son histoire.

Mon histoire commence en février 1983. J’ai été appréhendé chez moi en soirée. Je m’apprêtais à me rendre aux entraînements (Ndlr. Il est boxeur à l’époque au Canon Boxing Club de Yaoundé et à l’équipe nationale du Cameroun) quand des gens se sont présentés chez moi. Ils ont fait des perquisitions dans ma maison, ils n’ont rien trouvé. Je ne savais même pas ce qu’ils cherchaient. C’était des antigangs de la police judiciaire (PJ). Après la fouille, ils m’ont conduit dans les cellules de la PJ. J’y ai passé trois jours avant de savoir que j’étais accusé de vol aggravé chez un certain Alexandre Messoa. C’était un oncle. Ancien douanier, son beau-fils était le ministre Jérôme-Emilien Abondo. Ce dernier a notamment été ministre de la Défense et de l’Administration territoriale, etc. Son épouse, qui était la fille du plaignant, est avocate. Mon grand-père était aussi un haut commis de l’État à l’époque. Vers les années 1940, il était receveur des PTT. C’est pendant ce temps qu’il a connu mon père, Charles Okala, André Fouda, Charles Assale, Amadou Ahidjo, etc. Je ne sais pas quels sont les différends qu’ils avaient, mais avec le temps, je perçois que j’ai été victime d’un règlement de compte.
Mais revenons à l’histoire. Au début, il paraît que j’étais soupçonné de braquage. Comme ils n’ont pas trouvé d’armes chez moi lors de la perquisition, ils ont transformé l’accusation en vol aggravé. J’ai passé 38 jours à la police judiciaire. Puis les aller-retour entre le parquet, le commissariat central et la PJ ont commencé. Ce manège a mis une semaine. À ce moment, ils m’ont envoyé un autre monsieur. Joseph Anguissa. Il était censé être mon complice, mon coaccusé. Soumis à la torture, il n’a pas résisté.Les méthodes de torture au Cameroun à ce moment-là étaient quasiment restées les mêmes que celles qu’on utilisait pour les «maquisards». On maniait encore la «balançoire». J’ai été menotté aux pieds et aux mains, entre les deux, un bâton qui faisait le lien. Du coup, on pouvait le tourner à volonté. J’ai résisté parce qu’à l’époque j’étais encore athlétique, fort et robuste. Malheureusement mon coaccusé ne pouvait pas faire de même. Alors lorsqu’on lui posait une question, il disait oui. Voilà les aveux qui nous ont conduits à nouveau au parquet. Ici, le maître de céans était le procureur Léon Menti. Avant même de signer notre mandat de dépôt, il avait déjà prononcé notre sentence. Il avait dit «vous serez condamnés à mort». Effectivement peu de temps après, le 16 décembre 1983 nous avons été condamnés à mort par le tribunal de grande instance de Yaoundé. La peine de mort fut confirmée le 8 janvier 1985. Mon grand-père Vincent Olama Omgba a fait tout ce qui était à son pouvoir pour me sortir de cette situation. Il a même donné de l’argent à un avocat. C’était Me Icarré, un Antillais. Son cabinet était sis l’immeuble de la PJ. J’ai comparu jusqu’à la confirmation de la peine sans être assisté. Lorsque ma peine fut confirmée, mon grand-père a engagé un autre combat pour être remboursé.
Destination Tcholliré
De 1983 à 1990, on nous a incarcérés à la prison centrale de Yaoundé. Le 14 juin 1990, nous avons été transférés au centre de rétention criminelle (CRC) de Tcholliré. En quittant Yaoundé ce jour-là, nous étions quelque 118 condamnés à mort. Il y a un autre convoi venant de Garoua et un autre de N’Gaoundéré , ce qui faisait un total de 138 personnes. Quand je sortais en 2003, il n’en restait que 36, les autres étaient déjà morts ! Beaucoup sont morts à cause des conditions de détention, quelques-uns sont morts exécutés et les autres sont partis parce que leur séjour était sans doute terminé sur terre. Lorsque nous sommes arrivés au poste de police de Tcholliré, nous avons trouvé les anciens gendarmes et gardiens de prison : ceux-là mêmes dont la réputation n’est plus à faire, ceux qui gardaient les anciens prisonniers politiques. Il faisait noir et pour rejoindre nos cellules, il fallait que l’un d’entre eux tienne une lampe tempête. Un autre bouclait la file. Ils nous disaient qu’il fallait exactement marcher sur leurs pas parce que si quelqu’un se risquait à faire un écart, il se retrouverait dans les fosses qui bordaient le sentier de part et d’autre. Et effectivement il y avait des fosses autour de la prison dans lesquelles si tu faisais un faux pas, tu n’en sortais pas vivant.
Les gens n’ont vraiment aucune idée de Tcholliré à cette époque-là. Je pense que les gens n’ont aucune idée de ce camp de la mort. C’était l’enfer. La réclusion était vraiment continuelle. Le régime était strict : les détenus ne sortaient pas, ils ne voyaient pas le soleil, ils restaient confinés dans leur cellule. Il y avait le froid, l’obscurité et la solitude. Tout ceci accentué par le fait que pour accéder à la prison, il faut passer par un bac puisqu’elle a été construite sur une sorte d’île au milieu d’un fleuve, le Mayo. Il y avait de nombreuses maladies liées aux mauvaises conditions de détention. Tenez, le lendemain du jour où nous avons foulé le sol de Tcholliré, il y avait déjà un mort. Il devait s’appeler Ze Nkolo.
Quelques temps après, un beau matin nous nous sommes réveillés avec 12 cadavres d’un coup. C’est cet incident qui m’a poussé à me réveiller, telle une piqûre de rappel. J’ai commencé à revendiquer. Je me suis souvenu qu’il y a un décret qui avait été pris le 28 décembre 1992. Il s’agissait de la commutation de la peine de mort en peine privative de liberté pour une période n’excédant pas 20 ans. Malgré l’existence de ce texte, j’ai encore passé dix ans avant de voir le début de son application. La raison de ce délai est toute simple. Mon plaignant, Alexandre Messoa était un homme puissant comme on disait à l’époque. Par ailleurs pendant que j’étais à Tcholliré, mon dossier se trouvait à Bertoua. C’est grâce à l’archidiocèse de Yaoundé et à la représentation camerounaise de Prisonniers sans frontière qu’il a été retrouvé.
Conditions de détention
Quelqu’un nous avait soufflé en 1990 que si on arrivait à passer deux ans dans les murs de la prison de Tcholliré, on ne mourrait plus de mauvais traitement. Quand nous sommes arrivés, on nous a mis dans un bâtiment qualifié «Bâtiment Yaoundé». Là, nous nous sommes concertés entre détenus. Il était question de ne pas se laisser faire. Nous étions 16 dans une cellule. Ce groupe a pris une décision grave. Nous nous sommes dit que nous devrions rentrer à Yaoundé par tous les moyens. Nous étions décidés à partir ou à mourir ce jour-là. Le danger quand on est condamné à mort est réduit à sa stricte expression. Dix jours après notre arrivée c’était la Coupe du monde de football. Le Cameroun jouait contre la Colombie. Pendant que les geôliers étaient occupés à suivre la rencontre, nous étions en train de scier les barres de nos cellules. Nous avions été aidés par le ciel qui nous avait envoyé une fine pluie. Il y a eu une évasion massive. Après il a fallu neutraliser les barbelés de haute tension qui entouraient la prison. Une fois dehors, la réalité nous a rattrapées avant les autorités. À Tcholliré, on ne connaissait personne chez qui se réfugier. Quand les gendarmes ont mis la main sur nous, nous avons eu la vie sauve grâce Pascal Mani, alors préfet dans la localité.
Lorsqu’on nous a repris, on nous a conduits à la brigade de la ville. Pendant ce temps, le régisseur a été informé. Au CRC, lorsqu’on arrêtait les évadés il n’y avait pas de demi-mesure. Beaucoup sont morts à coups de machettes, de manches de brouettes, de gourdins, etc. Je pense notamment à Martin Ebah. Lorsque le préfet nous a retrouvés à la brigade, il a dit au régisseur qu’on ne touche à personne. Puisque les gardiens se réjouissaient, gloussant déjà d’aise à l’idée de la bastonnade à mort qu’ils nous feraient endurer. Grâce à l’intervention de M. Mani, ce châtiment extrême nous a été épargné. Malgré cela, nous avons subi des tortures ; nous avons passé au moins six mois sans matelas. Nous dormions à même le sol.
Sur un total de près de 300 détenus venus de toutes les provinces du pays, 76 étaient décédés en moins de quatre mois. Quant à moi, le mauvais régime alimentaire avait eu raison de ma santé. Il faut s’imaginer le régime auquel nous étions soumis au quotidien, au fil des semaines, des mois et des années. On mangeait continuellement des feuilles appelées localement «tasba’a», des feuilles d’arachide sauvages. Ces feuilles ont une odeur caractéristique. On en faisait une soupe que nous avions surnommée la «sauce aux brindilles». Pour varier un peu, les gardiens nous concoctaient aussi des feuilles de kapotier bouillies à l’eau salée. Et en guise d’accompagnement, un éternel couscous de maïs. En fait c’était du couscous quand on voulait prendre cet aliment comme de la bouillie. Mais il s’agissait davantage d’une bouillie quand se mettait à trop penser au couscous.
Que dire du régisseur Etienne Bassomo ? Il nous disait qu’à Tcholliré Dieu c’est lui, l’intendant Zingla était Jésus tandis que les gardiens étaient des anges.
La mort était omniprésente. Tous les ingrédients étaient réunis pour conduire le plus intrépide au tombeau. Parmi les détenus que la maladie n’avait pas déjà emportés, beaucoup perdaient la tête. Avant l’arrivée de la mission de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés, nous avions des détenus qui ne pouvaient même plus se tenir debout. Ceux-là marchaient à quatre pattes. Il y a ceux qui étaient allongés continuellement. C’était une lutte incessante contre le froid notamment en décembre. En janvier il y avait la solitude, les maladies, les moustiques. On pouvait passer toute une nuit sans dormir. Des fois quand j’étouffais, je courais coller mon nez contre le Juda de la porte pour happer un peu d’air frais. On peut le dire, ce n’était pas le paradis.
« Toute ma famille était morte
Le 20 juin 1991, c’est-à-dire un an, six jours après notre arrivée, j’ai reçu ma première visite. Mon grand-frère et sa femme sont venus me rendre visite. La rumeur de mon exécution courait déjà dans ma famille à Yaoundé. Pour arriver jusqu’à moi, ça n’a pourtant pas été simple. Ils ont copieusement été arnaqués par les gardiens. Il fallait monnayer pour arriver jusqu’à moi.
Pour survivre, je m’étais dit qu’il suffit de vivre au jour le jour sans penser à l’avenir. Et toujours je pensais à ma famille. Quand j’étais dans la cellule, je me figurais que je suis avec mon frère, ma sœur ou ma mère. Je les voyais comme si je parlais avec eux tous les jours. L’amour que je portais pour chaque membre de ma famille me donnait quand même du sens à ma vie. Je revivais mes combats de boxe, mes victoires. Je crois que si on m’avait dit à ce moment-là que toute ma famille était morte…
Par ailleurs à chaque moment, une rumeur revenait selon laquelle la prison serait fermée à une date précise. Qu’il y aurait un transfèrement. Cette perspective suscitait de l’espoir. Certains d’entre nous en avaient besoin pour supporter l’insupportable. Mais lorsque la date arrivait, certains craquaient et d’autres résistaient. Je me suis interrogé dans mon cahier de bord sur ce qui faisait la différence entre ceux qui tenaient et ceux qui craquaient. De mon point de vue, ce n’était pas une question de force physique ou psychologique. C’était une question de sens. Ceux pour qui la vie n’avait plus aucun sens abandonnaient, craquaient et mourraient en quelques jours. «Même illusoire écrivais-je alors, le sens permet de rester vivant». Donc quand la date passait, il fallait rapidement trouver une nouvelle perspective qui fasse sens sinon c’était la fin. Mais le plus difficile c’était justement de trouver un élément qui fasse sens dans cet univers. De ce point de vue, la spiritualité jouait un rôle cardinal.
Voilà comment j’ai pu tenir jusqu’à ma libération en 2003 après avoir passé vingt ans dans les prisons du Cameroun. Dix ans après ma libération, je continue à proclamer que je suis innocent. Mais si j’ai attendu tout ce temps, c’est parce que tous ceux qui m’ont envoyé en prison étaient encore vivants. Après tout cependant, il fallait briser le silence.